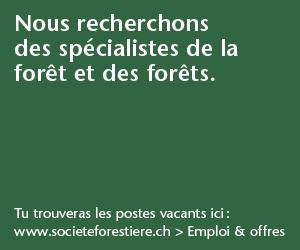- Bloc-notes
Approches suisse et française pour l’adaptation des forêts aux changements climatiques
16.12.2024

Bloc-note
Abstract
Les forêts suisses et françaises font face à des défis similaires liés aux changements climatiques. Des outils sont nécessaires pour guider les gestionnaires forestiers dans l’adaptation de leurs pratiques. La Suisse utilise une approche stationnelle basée sur les types de stations avec l’outil Tree App, tandis que l’Office National des Forêts, gestionnaire des forêts publiques françaises, se concentre sur les niches climatiques des essences avec l’outil Zoom 50. Malgré leurs différences, les deux approches visent à anticiper les changements climatiques et à adapter la gestion forestière en conséquence. Favoriser davantage d’échanges franco-suisses permettrait d’intéressantes synergies et apprentissages.
* Zürcherstrasse 111, CH-8903 Birmensdorf, courriel jeanne.portier@wsl.ch
Les forêts suisses et françaises subissent déjà les effets des changements climatiques. On observe davantage de sécheresse durant la période de végétation des arbres, menant à des dépérissements marqués dans plusieurs massifs. On observe également des effets indirects comme la propagation de ravageurs. Ces nouvelles conditions sont amenées à modifier la répartition géographique des essences. Celle-ci découle directement de leur niche écologique, représentant l’ensemble des conditions environnementales, principalement liées au climat et au sol, étant favorables à leur développement. En gestion forestière, l’étude des niches écologiques est donc fondamentale: les actions du forestier influencent les services écosystémiques offerts par la forêt et face aux changements climatiques, déterminent la vulnérabilité des massifs pour les décennies à venir.
Face à ce constat, les forestiers suisses et français doivent prendre des décisions éclairées afin d’adapter leurs pratiques. Les organismes de recherches et développement et les gestionnaires forestiers se sont concertés et ont développé des approches permettant d’orienter les décisions. De ces travaux sont nés deux outils, Tree App en Suisse1 et Zoom 50 en France dans la région frontalière Auvergne-Rhône-Alpes, adapté de l’outil français ClimEssences2 par Noémie Pousse de l’Office National des Forêts (ONF). Bien que les deux pays soient limitrophes, partagent des massifs forestiers et fassent face à des problématiques communes, leurs approches diffèrent. Mieux comprendre leurs similitudes et différences peut ainsi permettre d’apprendre les uns des autres afin d’adapter au mieux les pratiques de gestion.
Deux approches conceptuelles, un but commun
La Suisse adopte une approche se reposant sur la détermination de types de stations, c’est-à-dire d’associations forestières (p. ex: hêtraie à sapin typique). Depuis la fin des années 2000, il existe une nomenclature et une classification d’environ 300 types de stations (Frehner et al 2005), permettant un langage commun entre les forestiers suisses. Ces types de stations sont groupés par écogramme, à l’intérieur desquels ils sont répartis en fonction des conditions chimiques, structurelles et d’humidité du sol. Chaque écogramme est associé à l’un de 13 étages de végétation. Ceux-ci dépendent de l’écorégion dans laquelle ils se situent (figure 1), des conditions climatiques, topographiques (altitude par exemple) et des essences dominantes (Frehner et al 2018). Alors que l’appartenance des écogrammes aux étages de végétation et celle des types de station aux écogrammes sont fixes, les étages de végétation dépendent des conditions climatiques et peuvent se déplacer. Tree App assume ainsi un déplacement des étages de végétation en altitude en réponse à la hausse des températures (Zischg et al 2021). L’approche stationnelle permet donc de s’interroger sur la viabilité des types de stations actuellement en place en fonction des conditions climatiques futures attendues à chaque étage de végétation et dans chaque écorégion.

En France, l’ONF adopte une approche basée sur les niches climatiques des essences forestières, indépendamment les unes des autres. Les niches climatiques sont définies à l’aide de données de présence des espèces à l’échelle européenne (figure 2) croisées avec les observations climatiques. Cette échelle permet de prendre en compte des conditions climatiques encore non observées en France mais pouvant potentiellement survenir dans le futur. Les zones favorables ou défavorables à la présence et au développement des 61 essences étudiées peuvent ensuite être définies selon différents scénarios climatiques futurs. L’outil Zoom 50 apporte donc des éléments d’aide à la décision en complément d’autres diagnostics stationnels et sylvicoles réalisés par les forestiers.
Principes et fonctionnement des deux outils
La comparaison du fonctionnement général des deux outils (figure 3) montre que bien que l’approche conceptuelle diffère d’un pays à l’autre (approche stationnelle basée sur diverses variables environnementales en Suisse versus approche de niche climatique des essences en France), les outils développés ont de nombreuses similitudes, notamment sur l’utilisation de scénarios climatiques futurs et l’applicabilité des résultats en gestion.
L’outil suisse Tree App utilise des scénarios de changement climatique allant de «modéré» à «prononcé», respectivement +3,1°C et +4,3°C; –2% et –20% de précipitation en moyenne d’avril à septembre par rapport à la période 1981–2010 d’ici la fin du 21e siècle (Allgaier et al 2017). Ces changements peuvent induire dans Tree App un déplacement des étages de végétation de 500 à 700 m en altitude. Ainsi, pour une parcelle donnée, le type de station attendu à la fin du siècle peut correspondre à celui actuellement observé un à trois étages de végétation plus bas sur les mêmes conditions de sol.
Par exemple, à la localisation sélectionnée par l’utilisateur sur la figure 3, la station actuellement observée est une hêtraie à sapin typique (18) de l’étage montagnard supérieur. Tree App suggère que d’ici la fin du siècle sous un scénario climatique «modéré», l’étage de végétation se déplacerait à montagnard inférieur et une station adaptée serait une hêtraie à millet typique (8a). En plus de ce diagnostic, Tree App propose également des recommandations d’essences pour la station attendue en identifiant les essences les plus adéquates, déclinées en quatre niveaux.
En France, plusieurs scénarios de changements climatiques sont intégrés à l’outil Zoom 50: optimiste (SSP 3 – RCP 2,6 ≈ +2,1°C par rapport à la période 1981–2010), intermédiaire (SSP 3 – RCP 7 ≈ +4,6 °C), et pessimiste (SSP 5 – RCP 8,5 ≈ +6,1°C). Chaque scénario fait aussi varier les pluviométries sur l’année. La résolution des variables climatiques à une échelle de 50 m permet de prendre en compte les variations climatiques liées à la topographie, accentuées en zone de montagnes. Zoom 50 traduit la niche climatique des essences en seuils de tolérance pour trois indicateurs synthétiques (déficit hydrique, excès de froid et besoin en énergie, figure 3). Le déficit hydrique intègre indirectement les caractéristiques du sol par le biais de la réserve utile, représentant la quantité d’eau stockée dans le sol et disponible pour les arbres, pouvant ainsi atténuer l’impact des sécheresses. Il est ainsi le principal indicateur expliquant l’(in)compatibilité des espèces au climat futur. Cette (in)compatibilité est obtenue en comparant des valeurs de déficits hydriques futurs avec les seuils de tolérance au stress hydrique des essences (par exemple, 148 mm pour l’épicéa commun, 177 mm pour le sapin pectiné, 274 mm pour le chêne sessile, 401 mm pour le chêne pubescent). L’indicateur de froid hivernal affecte quant à lui les limites de répartition des essences qui avec le réchauffement peuvent se déplacer plus en altitude.
Les cartes de compatibilité climatique générées par Zoom 50 permettent de visualiser avec un code couleur les différents niveaux de risque pour chaque essence selon les scénarios climatiques utilisés. Bien qu’elles ne fournissent pas directement de recommandations pour la sylviculture, elles constituent une base décisionnelle lorsqu’elles sont combinées à d’autres outils complémentaires. La carte de gauche sur la figure 3 montre par exemple que le sapin pectiné à la base du massif jurassien, proche du canton de Genève, ne sera plus adapté aux conditions de stress hydrique dès le scénario climatique optimiste.
Que retenir de cette comparaison?
Les projections climatiques suggèrent que dans chacun des deux pays, les conditions climatiques futures surpasseront les conditions climatiques jusqu’alors rencontrées par les peuplements forestiers. Alors que la France répond à cette problématique en considérant les enveloppes climatiques des essences à l’échelle européenne, ce n’est pas le cas de la Suisse qui calibre ses modèles sur les stations rencontrées sur son territoire uniquement. Cette limite pourrait être levée avec l’étude de stations françaises pouvant être adaptées aux conditions suisses de la fin du siècle. La vallée du Rhône française et les Alpes du Sud constitueraient des zones prometteuses à étudier. Le massif jurassien et le massif alpin tous deux frontaliers seraient également des lieux favorables aux échanges de données, de résultats et d’expériences entre les deux pays.
La synécologie, c’est-à-dire l’autoécologie des essences à l’échelle d’un collectif d’arbres, n’est pas intégrée dans Zoom 50. Bien qu’elle ne soit pas non plus directement intégrée dans Tree App, l’observation à l’échelle de la station permet de conserver les liens qui peuvent exister entre les individus et espèces et qui pourraient potentiellement expliquer la résilience de certaines associations forestières. La France pourrait ainsi s’inspirer de l’approche stationnelle suisse afin d’aller au-delà de l’étude individuelle des espèces.
L’adoption de cette approche en France permettrait de prendre des mesures d’adaptation favorisant une conversion progressive vers des habitats et des espèces mieux adaptées à la nouvelle station. L’approche stationnelle permet par ailleurs de transposer des directives adaptées au contexte pédoclimatique local à travers l’aménagement forestier, ce qui est difficilement rendu possible avec l’approche par essence. L’hétérogénéité des stations sur le territoire français rend cependant difficile l’élaboration d’une typologie nationale. Toutefois, cela pourrait être développé à l’échelle des grandes régions écologiques.
Conclusion
Face aux changements climatiques, promouvoir une gestion forestière et des forêts résilientes est devenu une priorité évidente de chaque côté de la frontière. Bien que les méthodes et outils diffèrent entre la Suisse et la France, leur objectif demeure le même: anticiper les changements climatiques et leurs incertitudes afin de déterminer les essences à favoriser et celles pour lesquelles l’avenir est incertain ou compromis. Ces outils, bien qu’ils ne se substituent ni à l’œil averti ni au bon sens des gestionnaires forestiers, fournissent des informations essentielles pour précibler les zones nécessitant une adaptation forestière prioritaire. Afin de créer des synergies et tirer parti des expertises transfrontalières, il serait ainsi intéressant de renforcer les échanges et collaborations franco-suisses entre les divers acteurs forestiers.
Literatur
La forêt suisse face aux changements climatiques: quelles évolutions attendre? Not. prat. 59. 12 p.
Gestion durable des forêts de protection. Soins sylvicoles et contrôle des résultats: instructions pratiques. (L’environnement pratique). Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage. 564 p.
Bases stationnelles pour la gestion forestière face au changement climatique. WSL. Ber. 69: 44 p.
Participatory modelling of upward shifts of altitudinal vegetation belts for assessing site type transformation in Swiss forests due to climate change. Appl Veg Sci 24: e12621.https://doi.org/10.1111/avsc.12621